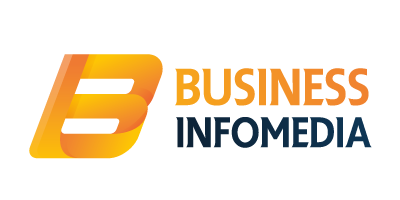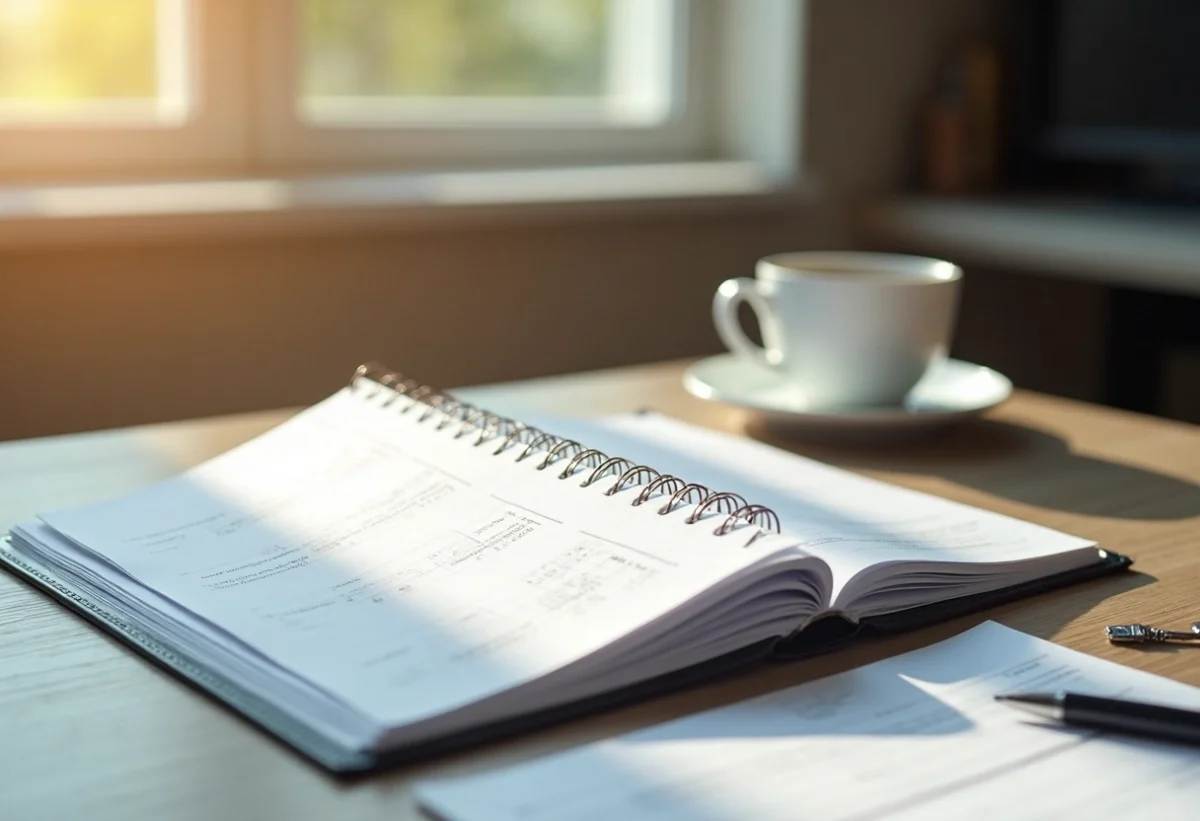Un salarié en arrêt maladie peut désormais acquérir des congés payés au même titre qu’un salarié en activité, selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Cette évolution bouleverse des décennies de pratique en entreprise et impose aux employeurs de revoir la gestion de leurs compteurs d’absence.
La loi française encadre strictement l’acquisition, la prise et l’indemnisation des congés payés, mais des exceptions demeurent concernant les périodes assimilées, les reports en cas d’arrêt de longue durée ou la prescription des droits. Les derniers ajustements législatifs accentuent la nécessité d’une veille rigoureuse pour éviter les contentieux.
Panorama des congés payés en France : principes et cadre légal
Le Code du travail n’y va pas par quatre chemins : chaque salarié, peu importe la nature de son contrat ou la taille de la structure, a droit à des congés payés. La mécanique est claire : la période de référence s’étend le plus souvent du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Pendant cette fenêtre, le salarié engrange 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour un temps plein, le compteur grimpe à 30 jours chaque année.
Mais la réalité ne s’arrête pas à ce cadre général. Les conventions collectives et accords propres à chaque entreprise offrent fréquemment des droits bonifiés. La réglementation congés payés prévoit divers ajustements : fractionnement possible, jours supplémentaires liés à l’ancienneté ou à la situation familiale, modalités particulières dans la fonction publique, ou encore calcul en jours ouvrés selon les secteurs.
La France n’évolue pas en vase clos : la directive européenne sur les temps de repos impose sa marque. Les décisions de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pèsent sur la gestion des absences, notamment lors d’arrêts maladie ou d’accidents du travail. Sous la pression européenne, Paris a dû remanier ses textes pour faire coller le droit congés payés aux standards communautaires.
Pour mieux cerner le dispositif, il faut identifier les pivots du système :
- La période d’acquisition : fixée par défaut, mais ajustable par accord collectif ou convention.
- Le calcul : jours ouvrables ou jours ouvrés, selon ce qui est négocié ou imposé dans la branche.
- La prise : encadrée par l’accord de l’employeur et la bonne marche de l’organisation collective.
Le socle reste commun, mais la réalité sur le terrain dépend beaucoup des accords signés et des usages propres à chaque entreprise.
Quels sont les droits des salariés en matière de congés payés ?
Le droit au congé s’impose à tous : chaque salarié, dès son arrivée dans l’entreprise, commence à accumuler des congés payés. La règle, inscrite dans le code du travail, garantit l’acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, ce qui équivaut à cinq semaines par an. L’organisation est loin d’être laissée au hasard. Le congé principal, qui doit atteindre au moins douze jours ouvrables consécutifs, se prend généralement entre le 1er mai et le 31 octobre, sauf autre disposition dans les accords collectifs.
La réglementation congés payés veille à ce que la rémunération ne disparaisse pas pendant l’absence. Une indemnité de congés payés compense la perte de salaire, calculée selon deux méthodes : soit maintien du salaire, soit 1/10e de la rémunération brute de la période de référence. Le calcul le plus favorable s’applique systématiquement.
Des situations particulières existent : les jeunes travailleurs, travailleurs handicapés ou salariés ayant des enfants à charge peuvent prétendre à des jours supplémentaires. Les arrêts liés à la maladie professionnelle, à un accident du travail ou à un congé maternité n’entraînent plus de perte d’acquisition de congés payés, suite aux dernières décisions de justice et réformes.
Trois dispositifs majeurs sont à connaître pour appréhender la diversité des droits :
- Indemnité compensatrice de congés : elle s’applique si le salarié quitte l’entreprise sans avoir pu consommer tous ses jours acquis.
- Congés spécifiques : adoption, paternité, parental, qui ne sont pas déduits du quota annuel de congés payés.
- Caisses de congés payés : dans certains secteurs comme le BTP ou le spectacle, elles gèrent les droits et les paiements, assurant ainsi la continuité d’un employeur à l’autre.
Les textes, les accords collectifs et les parcours personnels se mêlent pour façonner le quotidien du droit congés payés pour chaque salarié.
Gestion pratique : organisation, prise des congés et obligations de l’employeur
La prise des congés payés répond à une organisation précise. L’employeur décide de l’ordre des départs après avoir consulté le comité social et économique (CSE), là où il existe. Les dates de congés doivent être communiquées aux salariés au moins deux mois avant leur démarrage. L’équilibre à trouver : combiner les impératifs du service et, si possible, les préférences des salariés. Les règles peuvent être affinées par accord collectif, notamment pour le fractionnement ou le report des congés payés.
Le fractionnement permet, sous certaines conditions, de découper le congé principal et d’obtenir des jours en plus. Le report des congés reste une exception : il impose l’accord de l’employeur, sauf en cas de force majeure ou de congés maternité, paternité ou adoption. Pour demander ses congés, le salarié doit respecter un préavis, souvent d’un mois, sauf disposition différente dans l’entreprise.
L’employeur a interdiction d’imposer une période de congé sans suivre la procédure, sous peine d’être sanctionné. La réglementation congés payés prévoit aussi le versement d’une indemnité compensatrice si le salarié quitte l’entreprise sans avoir utilisé ses jours acquis. Dans des secteurs comme le BTP ou le spectacle, la gestion et le paiement sont confiés à des caisses de congés payés, ce qui garantit la portabilité des droits d’un employeur à l’autre.
Pour clarifier les points d’organisation, voici les règles pratiques à connaître :
- Organisation des congés : relève de la direction, dans le respect des textes collectifs.
- Dialogue social : consultation du CSE obligatoire pour fixer les périodes de congé.
- Préavis et formalités : respect du délai, affichage des dates et notification individuelle à chaque salarié.
Nouvelles réglementations et évolutions récentes à connaître
L’année 2023 a marqué un tournant : la réglementation congés payés a été profondément remaniée. Un arrêt majeur de la Cour de cassation a ouvert la voie à l’acquisition des congés payés pour les périodes d’absence pour maladie non professionnelle. Un salarié en arrêt de travail n’est plus privé de cette acquisition, qui s’aligne sur la jurisprudence de la CJUE et la directive européenne, instaurant ainsi une égalité de traitement sur la période de référence.
La loi dite DDADUE traduit ces évolutions dans le droit français. Le report des congés payés change d’échelle : lorsqu’un salarié n’a pas pu prendre ses jours à cause d’un arrêt maladie, il dispose désormais d’une période de quinze mois à partir du moment où l’employeur l’informe de ses nouveaux droits. Ce nouveau délai, inspiré du droit européen, oblige les entreprises à notifier avec précision les droits acquis sous peine de voir les reports s’allonger.
Autre changement majeur : la limitation de l’acquisition des congés lors d’absences prolongées. La loi pose désormais un plafond : quatre semaines de congés payés par an, même pour un arrêt maladie longue durée. Le mode de calcul ne distingue plus entre maladie professionnelle ou non, à l’exception des cas de maladie professionnelle ou accident du travail qui continuent de bénéficier d’une protection renforcée.
Pour s’y retrouver dans ces évolutions, voici les principales nouveautés à retenir :
- Acquisition des congés étendue : les arrêts maladie non professionnels comptent désormais pour le calcul des droits.
- Période de report harmonisée : quinze mois à compter de la notification des droits au salarié.
- Plafond d’acquisition : quatre semaines par an, sauf en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail.
La gestion des congés payés ne cesse d’évoluer, portée par les réformes et les décisions de justice. Pour les salariés comme pour les employeurs, rester attentif à ces mutations, c’est éviter les mauvaises surprises et se donner les moyens de défendre ses droits. Demain, la prochaine jurisprudence pourrait bien rebattre à nouveau les cartes.